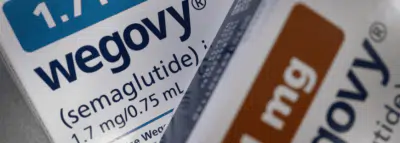Selon une étude publiée par la Fondation de France, en 2022, 11% des personnes âgées de plus de 15 ans se trouvaient dans une situation d'isolement relationnel, c'est-à-dire qu'elles ne rencontrent jamais ou très peu de personnes en dehors de leur foyer. L'étude appelle à "déstigmatiser" la solitude pour inciter les personnes concernées à demander de l'aide.
Certaines catégories de personnes sont plus exposées
Depuis 2010, les personnes aux revenus modestes ont toujours une proportion plus élevée de personnes isolées que le reste de la population, selon la Fondation de France. En 2022, 15% des personnes aux revenus modestes étaient isolées, contre seulement 8% des personnes aux revenus élevés. Le chômage aggrave également la situation d'isolement social, surtout après la crise sanitaire : 21% des chômeurs étaient isolés en 2022, contre 18% en 2020, selon le rapport. En revanche, la proportion de personnes isolées parmi la population active a diminué entre 2020 et 2022, passant de 14% à 10%.
Les personnes qui restent au foyer ou qui ne possèdent pas de diplôme sont aussi plus susceptibles de se sentir isolées, car "le travail domestique à temps plein accentue la sensation de retrait du monde social" et "les métiers peu qualifiés comportent une faible valeur ajoutée en matière relationnelle". Le phénomène peut être aggravé par les difficultés de certains groupes, comme les seniors, à maîtriser les outils numériques, mais peut aussi être renforcé par une "surconsommation" des réseaux sociaux. La solitude affecte par ailleurs davantage les parents célibataires ou les personnes vivantes ou ayant vécu en communauté, selon la Fondation de France.
L'impact du Covid
"Ce qui est sûr, c’est que le Covid a profondément bouleversé le rapport des individus à la vie sociale, qui s’articule davantage aujourd’hui autour des liens de proximité, avec les voisins ou la famille. La crise a aussi eu pour effets de renforcer la solitude des personnes déjà exposées et de révéler des situations d’isolement méconnues ou sous-estimées. Des personnes plutôt intégrées socialement, comme les mères célibataires par exemple, ont été fortement impactées par le manque d’aide ou de soutien", explique sur le site de la Fondation, Hadrien Riffaut, chercheur-associé au Cerlis, Centre de recherche sur les liens sociaux et co-auteur de cette étude Solitudes 2022.
Ce rapport a été élaboré à partir d'une enquête statistique menée auprès de plus de 3 000 personnes résidant en France par le Crédoc (Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie). Il comprend également les témoignages de professionnels et de personnes exposées à la solitude recueillis lors d'une enquête ethnographique menée sur le territoire français, dans des zones urbaines et rurales.
La proportion de personnes se sentant isolées socialement était relativement stable entre 2010 et 2016, avec entre 9% et 12% de la population concernée. Elle a ensuite légèrement augmenté entre 2017 et 2020 avant d'atteindre un sommet inédit de 24% en 2021 en raison de la crise sanitaire. En janvier 2022, l'isolement relationnel a diminué significativement, mais concernait toujours 11% de la population, retrouvant ainsi son niveau d'avant la crise sanitaire.
Une vie sociale ne protège pas contre l'isolement
Bien que l'isolement social baisse, 20% de la population des personnes de plus de 15 ans ressentent encore un sentiment de solitude, un chiffre qui ne réduit pas malgré la fin de la pandémie. L'étude souligne également que même une vie sociale dense ne protège pas contre ce sentiment, 17% des personnes entourées disposant de plus de deux réseaux sociaux déclarent se sentir seules "presque tous les jours" ou "souvent". Ce sentiment de solitude est douloureux pour 80% des personnes, soit environ 9 millions de personnes en France.
La solitude peut s'installer progressivement à différents moments de la vie, généralement en raison d'une succession d'événements douloureux qui fragilisent les relations de l'individu. Cette entrée dans la solitude peut parfois devenir une solitude installée, qui doit être mieux détectée et accompagnée grâce à une coopération accrue entre les acteurs associatifs, recommande la Fondation de France.

La rédaction d'Assurland