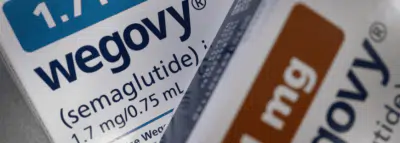L'infarctus du myocarde est la première cause de mortalité féminine en France, bien devant le cancer du sein. En effet, les femmes bénéficient d'une prise en charge tardive et d'un diagnostic plus lent, ce qui aggrave leur mortalité. Selon un rapport de l'Académie nationale de médecine, cette inégalité de soins se traduit par une mortalité hospitalière deux fois plus élevée que celle des hommes. Plusieurs facteurs expliquent cette situation : méconnaissance des symptômes, particularités anatomiques et sous-représentation dans les études médicales. Face à ce constat alarmant, des solutions doivent être mises en place pour améliorer la prise en charge des patientes.
Un retard de diagnostic et de traitement
Les femmes victimes d'un infarctus sont prises en charge avec un retard moyen de 30 minutes par rapport aux hommes. Ce délai s'explique en partie par une perception biaisée de l'infarctus comme une maladie masculine, qui conduit à un appel tardif aux urgences. Une fois arrivées à l'hôpital, elles subissent également un retard de diagnostic, car leurs symptômes sont souvent moins typiques que ceux des hommes.
Même après confirmation du diagnostic, le traitement reste moins efficace. L'angioplastie, qui permet de rétablir la circulation sanguine dans l'artère obstruée, est réalisée plus tardivement. De plus, les femmes bénéficient moins souvent des traitements recommandés après un infarctus, tels que les statines et les bêtabloquants, ainsi que de la réadaptation cardiaque, pourtant essentielle pour prévenir les récidives.
Ce constat alarmant souligne une inégalité préoccupante : la mortalité hospitalière des femmes victimes d'un infarctus s'élève à 9,6 %, contre 3,9 % chez les hommes.
Des spécificités féminines méconnues
Les particularités physiologiques des femmes compliquent également la prise en charge. Leurs artères coronaires sont plus petites et plus sinueuses, ce qui rend les interventions médicales plus délicates et augmente le risque de complications. Certaines formes d'infarctus, comme le syndrome de Takotsubo – aussi appelé "syndrome du cœur brisé" – ou l'infarctus sans obstruction coronaire, sont plus fréquentes chez elles et nécessitent des approches spécifiques.
Par ailleurs, plusieurs facteurs de risque sont propres aux femmes, notamment l'hypertension gravidique, la prééclampsie ou le diabète gestationnel. Pourtant, ces risques spécifiques sont encore trop peu pris en compte par les soignants. Un autre élément préoccupant mis en avant par l'Académie de médecine est l'impact des violences physiques sur la santé cardiovasculaire des femmes : celles qui en sont victimes présentent un risque accru de maladies cardiaques.
Des recommandations pour améliorer la prise en charge
Face à ces constats, l'Académie nationale de médecine propose quatre recommandations majeures :
- former les professionnels de santé, notamment aux urgences et au sein du SAMU, pour mieux identifier les signes de l'infarctus chez les femmes ;
- élaborer des protocoles de soins adaptés, prenant en compte les particularités anatomiques et physiologiques féminines, et améliorer l'accès à une réadaptation cardiaque spécifique ;
- sensibiliser le grand public afin que les femmes soient mieux informées sur les symptômes et facteurs de risque cardiovasculaires ;
- renforcer la recherche sur les maladies cardiovasculaires féminines, en favorisant leur inclusion dans les études cliniques et en analysant les facteurs de risque émergents.
Chaque jour en France, 200 femmes meurent d'une maladie cardiovasculaire. Une meilleure reconnaissance des symptômes et une prise en charge adaptée sont essentielles pour réduire cette surmortalité évitable.

La rédaction d'Assurland