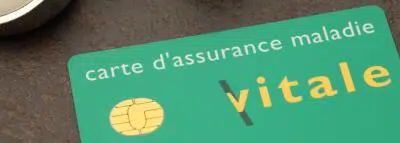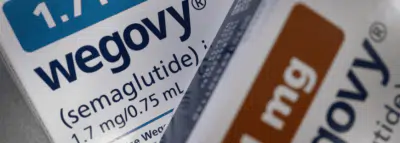Alors que le déficit de la Sécurité sociale ne cesse de se creuser, la Cour des comptes propose de repenser le remboursement des soins de santé en fonction des revenus des assurés. Une suggestion qui interroge le principe fondateur de l'universalité du système français et divise experts comme citoyens.
La Cour des comptes s'inspire du modèle allemand
Dans une note publiée le 14 avril, la Cour des comptes ouvre un débat sensible : et si le remboursement des médicaments, des actes chirurgicaux ou encore des équipements optiques dépendait du niveau de revenu des assurés ? Cette proposition, qui figure dans une section intitulée "Repenser le champ du remboursement par l'assurance maladie", s'appuie notamment sur l'exemple allemand.
En Allemagne, les patients participent aux frais de santé selon leurs revenus, dans la limite de 10 euros par jour ou de 2 % du salaire annuel. La juridiction financière française imagine un système comparable, où les foyers aux revenus les plus élevés seraient moins bien remboursés que les autres. Deux pistes sont alors évoquées :
- une contribution renforcée pour les actes dont l'efficacité médicale est jugée limitée (comme les cures thermales par exemple) ;
- un remboursement différencié selon les revenus, à l'image du modèle allemand.
Un modèle qui remet en cause l'universalité française ?
Depuis 1945, le principe d'égalité devant l'accès aux soins est un pilier du système français. Chaque assuré bénéficie du même taux de remboursement pour ses soins et ses médicaments, quel que soit son revenu. En cas de reste à charge, les complémentaires santé prennent le relais. Elles sont d'ailleurs devenues obligatoires pour les salariés.
Modifier cette règle constituerait une rupture. Une mesure de ce type avait déjà été évoquée en janvier dernier par Éric Lombard, directeur général de la Caisse des Dépôts : "Peut-être qu'on peut davantage segmenter les catégories de population. Être remboursé à 100 % des médicaments quand on a des revenus supérieurs à la moyenne, est-ce vraiment indispensable ?" Une proposition qui avait suscité de vives réactions.
Plus récemment, un député de la majorité, Jean-Carl Grelier, a déposé une proposition de loi visant à plafonner le reste à charge en fonction d'un pourcentage du revenu annuel des patients. Mais l'idée reste très clivante. Certains estiment qu'il est normal que ceux qui gagnent davantage contribuent plus, tandis que d'autres considèrent qu'il serait injuste de pénaliser des personnes qui, selon eux, ont mérité leur situation.
Un contexte budgétaire sous tension
La Cour des comptes estime qu'il faudrait réaliser 20 milliards d'euros d'économies sur l'Assurance maladie d'ici à 2029. Le déficit de la Sécurité sociale s'est déjà creusé à 15,3 milliards d'euros en 2024 et pourrait atteindre 19,9 milliards d'euros en 2028. Le gouvernement cherche donc des pistes pour contenir l'envolée des dépenses de santé, qui s'élèveront à 265,4 milliards d'euros en 2025 (Ondam).
Mais, certaines voix dénoncent une mesure difficilement applicable et potentiellement contre-productive. "On ne va pas quand même pas avoir une carte Vitale gold et une carte Vitale démonétisée !" ironise Philippe Besset, président de la Fédération des Syndicats Pharmaceutiques de France. Il rappelle également que la justice sociale en France repose déjà sur une contribution proportionnelle aux revenus via les cotisations sociales.
Enfin, le débat soulève la question du consentement à l'impôt : si les plus aisés perçoivent une moindre couverture, leur adhésion au système pourrait s'effriter. La ministre de la Santé, Catherine Vautrin, et Amélie de Montchalin ont elles aussi évoqué récemment la nécessité de "repenser notre modèle social" et la "gratuité qui déresponsabilise"

La rédaction d'Assurland